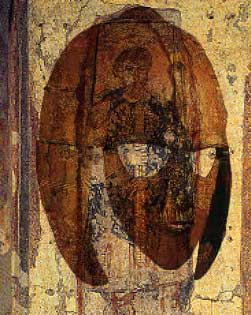|
|
|
Généralités sur le Haut Moyen Age et les débuts des Carolingiens
La civilisation romaine imprègne encore fortement la société française du haut Moyen-Age. L'Église catholique étend alors son influence sur une bonne partie de l'Occident. L'Empereur du IVe siècle détient presque tous les pouvoirs. Il est seulement aidé et soutenu pas ses amis, les comites d'où vient le nom de comte. Les Barbares sont alors aux portes de l'Empire ; certains ont été invités comme soldats ou paysans. Après l'invasion ou la grande migration des peuples barbares, l'Europe change très lentement si bien que certaines élites de l'époque romaine se rallient au nouveau régime. Seule la religion fait la différence. Les Barbares germaniques, bien que très peu nombreux, ont le pouvoir militaire et administratif. Dans la Gaule franque de Clovis la fusion se fait par les mariages, par l'unification des coutumes juridiques, par la conversion au catholicisme. Les traits barbares perdurent néanmoins longtemps : rôle de l'assemblée des hommes libres ; vengeances...
Une aristocratie de plus en plus puissante émerge au Ve siècle, les maires du palais effacent les rois mérovingiens. Pépin gouverne à la place de Carloman retiré dans un monastère. C'est le début de l'époque carolingienne. Charlemagne, plus que ses prédécesseurs se livre à la guerre, renforce son royaume et se met au service de l'Église. Charles se fait construire un palais à Aix-La-Chapelle, se comporte de plus en plus comme l'Empereur de Byzance et se fait finalement et logiquement sacrer en l'an 800. Avec l'âge, Charlemagne partage de plus en plus son pouvoir avec de grandes familles et inspecte ses territoires par l'intermédiaire des missi dominici. Le lien vassalique permet -par l'assurance du serment- de sceller la fidélité des comtes à l'Empereur et de vassaux aux comtes selon un processus rayonnant. Si Charlemagne choisit à la fin de sa vie le partage de son royaume, l'unité de celui-ci est sauvée par la mort précoce de deux de ses fils. Après Louis le Pieux cependant, les rivalités entre sa descendance et les menaces d'invasions Vikings sont responsables du déclin de la dynastie des Carolingiens.
Cette époque aura favorisé l'installation de l'Église. La nomination des évêques est de plus en plus soumise au bon vouloir de l'Empereur qui fait d'eux des vassaux soumis à l'ost. Sous Louis Le Pieux, les évêques conseillent l'Empereur. Le monachisme à l'époque carolingienne connaît une seconde jeunesse et contribue à la renaissance carolingienne.
Les invasions normandes, hongroises et des sarrasins forcent l'aristocratie à fortifier ses biens et à construire des châteaux. Les liens vassaliques se renforcent pour des raisons militaires. Les Carolingiens affaiblis se maintiennent jusqu'en 987 date de l'avènement d'Hugues Capet.
Introduction d'après Pierre Riché
Vie sportive et Guerrière de l'aristocratie carolingienne
Ceux qui possèdent les terres sont ceux qui se livrent à la guerre. L'équipement en effet coûte cher. Dès son enfance, l'aristocrate est préparé à la guerre. Raban Maur écrit à ce sujet : "Nous voyons aujourd'hui que les enfants et les adolescents sont élevés dans les maisons des grands afin d'apprendre à supporter la dureté et l'adversité, la faim, le froid, la chaleur du soleil. Un proverbe populaire, qui nous est familier, dit : "Celui qui ne peut être cavalier à l'âge de la puberté ne le pourra jamais, ou avec difficulté, à un âge plus avancé"". Vers 14 ans, l'enfant se voit offrir par son père une épée richement décorée qu'il devra conserver jusqu'à sa mort. Le cheval et l'apprentissage de son utilisation font partie de la tâche du jeune guerrier. La chasse enfin constitue un bon entraînement. C'est un sport dangereux.
Au mois de mai, le roi donne rendez-vous à tous ces vassaux pour combattre. En 807, ce service, l'ost, n'est demandé qu'à ceux qui sont propriétaires d'au moins trois manses. L'armée carolingienne est difficile à estimer (30 000 hommes à 100 000 hommes). Elle se met en marche ensuite vers les lieux du combat. Les chars accompagnent le mouvement ; ils sont remplis du ravitaillement et des outils. Pour les tirer, les chevaux sont sans doute déjà munis d'un collier d'épaule. Les soldats se livrent souvent à des pillages.
Les affrontements prennent souvent la forme de sièges. Les machines de guerre : béliers, catapultes pierrières, tours roulantes, trébuchets sont disposés autour des retranchements. Les butins sont parfois abondants comme lorsque les Carolingiens s'emparent du trésor des Avars.
La guerre est à cette époque à la fois un jeu et une œuvre sainte.
Les enfants de l'aristocratie
Dès l'âge de sept ans, le jeune aristocrate commence une éducation marquée par une certaine rudesse. Les enfants dans les monastères ne peuvent en principe renoncer aux vœux formulés pourtant par leurs parents. Le cas de Gottschalk est célèbre. Fils d'un comte saxon, offert très jeune à l'abbaye de Fulda. "Devenu adolescent, il demande à reprendre sa liberté. L'abbé Raban Maur refuse et, dans un long traité : Sur l'Oblation des enfants, soutient la validité de l'engagement pris par les parents. Pourtant le synode de Mayence de 829 accepte la demande du jeune homme qui, par la suite, devait se rendre célèbre par des thèses peu orthodoxes sur la prédestination".
L'éducation des enfants est marquée par une certaine rudesse symbolisée par l'usage du fouet. Hildemar, pourtant, dans son commentaire de la règle de Saint Benoît, donne quelques conseils aux maîtres : "Il doit agir avec modération et non les fouetter car ils reviennent aussitôt après la correction à leurs sottises. Il faut apaiser et corriger un maître qui, dans sa colère, réprimande un enfant au-delà de la mesure. La méthode forte peut rendre les enfants plus mauvais qu'avant"."
La sexualité des adolescents est très surveillée comme les jeux, qui sont minutés.
D'après Pierre Riché, L'Empire Carolingien, VIIIe-IXe siècles, Hachette
Dans la continuité de ce texte, vous pouvez consulter deux autres documents du site :
|
|
|