HISTOIRE GÉOGRAPHIE SUR LE WEB
|
||||
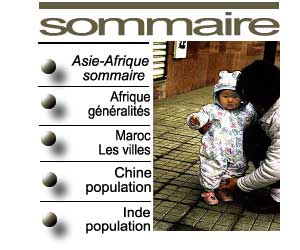 |
||||
HISTOIRE GÉOGRAPHIE SUR LE WEB
|
||||
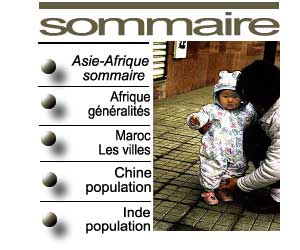 |
||||
GÉNÉRALITÉS SUR L'AFRIQUE
Cette carte peut être comparée avec la carte des milieux naturels d'Afrique mais les difficultés de l'Afrique ne s'expliquent pas seulement par les rigueurs du milieu. Je coche les affirmations qui sont vraies : La couleur noire indique les pays avancés. L'Afrique australe est composée de pays avancés. L'Éthiopie est classée parmi les pays avancés. Les pays du Maghreb sont des pays avancés. L'indice de développement humain du Zaïre (Congo) est compris entre 0,3 et 0,4. Les pays de la "corne de l'Afrique" sont avancés. Les pays d'Afrique noire sont généralement peu avancés.
Les causes du sous-développement africain sont complexes et multiples. Les facteurs historiques sont nombreux : la mono-industrie s'explique par le passé colonial de l'Afrique (l'organisation du territoire favorise le développement côtier) mais la colonisation n'explique pas tout ; l'Afrique semble un continent oublié par les échanges mondiaux ; l'importation de modèles de développement n'a pas été une réussite (marxisme planificateur et orienté vers l'industrie lourde). L'étude d'un document comme celui proposé plus haut nous apprend au moins une chose : il n'y a plus "une" Afrique mais "des" Afriques. L'Afrique est encore un continent rural même si la croissance urbaine est devenue impressionnante. Or les Africains font preuve d'une grande ingéniosité dans la culture de leurs terres et l'adaptation aux climats. La question est aujourd'hui de trouver un véritable levier pour sortir d'un développement lent et loin d'être harmonieux.
Commentaire : l'Afrique a longtemps été un continent sous-peuplé. La croissance démographique actuelle est celle d'un continent en transition démographique. Dans le détail, il est de nouveau difficile de parler d'une seule Afrique car les taux d'accroissement naturel varient sensiblement entre l'Afrique du sud, en phase descendante, et le Niger par exemple. Cette croissance profite maintenant à une urbanisation difficilement contrôlée ("une majorité d'États ont connu des taux supérieurs à 5 % par an (...) En 1940, la Côte d'Ivoire ne comptait que 3 % de citadins ; ils étaient 15 % en 1950, 32 % en 1975, aujourd'hui la moitié de la population" (voir géographie universelle RECLUS) mais aussi porteuse d'espoirs raisonnés.)
L'Afrique noire ou tropicale est dans une situation économique désastreuse. Le FMI et la Banque mondiale ont placé la plupart des pays sous tutelle. Ces années de rigueur n'ont rien arrangé : la situation sociale s'est au contraire dégradée. Les intellectuels se posent alors la question : comment sortir l'Afrique de son sous-développement ? L’Afrique est encore un continent encore profondément rural. Les agriculteurs sont tous confrontés au problème de l’eau et à la nécessité de nourrir des effectifs plus nombreux avec une main d’oeuvre restreinte et dont la productivité est faible. Les effectifs urbains sont toujours minoritaires. D'après Alain Dubresson, Jean-Yves Marchal et Jean-Pierre Raison, Géographie Universelle.
L'indice de développement donne une idée du niveau de développement d'un pays : plus il s'approche de 1, plus le pays concerné a de bonnes conditions de vie. Il est calculé en tenant compte de l'espérance de vie ; du niveau d'instruction ; du revenu moyen.
Population en 1970
Environ 370 millions d'habitants
Population en 2000
749 millions d'habitants (500 en Europe)
Densité
24,71 (101 en Europe)
Accroissement naturel de l'Algérie
24 pour mille (France 3)
Accroissement naturel du Niger
34
Accroissement naturel du Kenya
33
Accroissement naturel de l'Afrique du sud
22
Population urbaine en 1995
200 millions d'habitants sur 720
Prévision pour 2025
800 millions sur 1,5 milliards d'habitants
Superficie
30 300 000 km2
Sites cartographiques
Cartes
SOUS-DÉVELOPPEMENT
La colonisation de l'Afrique noire a été une épreuve tant le milieu naturel est hostile même sur Les côtes : fleuves en rapides ou désert sahélien, si bien que les Européens ont souvent préféré s'installer durablement en Asie ou en Amérique. La résistance de l'Afrique à son dépeçage a été faible comme la résistance à la "livraison des esclaves". Les investissements européens se sont limités à puiser cette main d'œuvre et à édifier quelques mines. L'Afrique tropicale ne fut redécouverte que sur le tard, après la seconde guerre mondiale, lorsque les puissances coloniales eurent besoin de redorer leur blason de conquérant. Au bout du compte, la colonisation n'a été qu'un moment dans l'histoire de l'Afrique.
Le mot crise pour désigner la situation actuelle de l'Afrique convient-il ? Ne s'agit-il pas plutôt d'une transition ? Il est vrai que l'Afrique noire (expression discutable) cumule des revenus inférieurs à ceux de la Belgique. En tendance comme avec les actuelles statistiques, nous parlons d'une des régions les plus pauvre au monde. La plupart des pays sont endetté même si ces données doivent être corrigées par le fait qu'une partie de la production est invisible ; qu'une partie de la population vit de sa production sans que celle-ci soit recensée. La croissance démographique est un facteur d'explication de la situation économique difficile ; elle engendre deux effets pervers : raréfaction des actifs et explosion d'une population jeune.
Les sécheresses qui se sont succédées depuis les années 60, l'avancée du désert ont provoqué des crises agricoles graves. Les agriculteurs africains sont de plus handicapés par leur mauvaise maîtrise des techniques de conservation de l'eau et d'irrigation comme ils le sont aussi par les médiocres infrastructures routières. A cela s'ajoute le nombre des pays en guerre et donc de réfugiés. Le taux d'urbanisation a augmenté même s'il demeure très sensiblement inférieur à celui de l'Asie. L'exode rural joue un rôle important dans cette croissance. Or les villes ne proposent qu'un nombre d'emplois dérisoire en l'absence de véritable politique industrielle.
Les matières premières représentent un poids écrasant dans la production et les échanges. Mais les pays européens se sont détournés des investissements miniers plus coûteux en Afrique avec la chute du prix des transports maritimes qui permet de puiser plus loin. C'est également la tendance pour la production agricole. L'Afrique n'a pas profité de la croissance mondiale depuis les années 60 et son tissu industriel ne s'est pas du tout modernisé. Ce constat ne doit pas faire oublier les erreurs commises par les investisseurs qui ont souvent raté leur cible : usines inadaptées et aide inappropriée.
Les États africains sont comme l'économie : en crise et désemparés. Les services et les infrastructures sont dégradées ; la fonction publique mal payée et donc gangrenée par la corruption. Inégalité entre les régions, insécurité dans les villes, abandons de projets agricoles et industriels : la seule solution trouvée par les États est la privatisation à outrance mais les usines ne trouvent pas preneur. Une société de subsistance s'organise ou une contre-société de trafics qui enfante ses gagnants et ses perdants. L'État se prive ainsi de ressources fiscales et douanières. CONTINENT RURAL
L’agriculture africaine est très diversifiée : “L’opposition est classique et majeure entre “zones guinéennes” et “soudaniennes”, “équatoriales” et “tropicales”, entre forêts denses humides et forêts claires, savanes et steppes. D’un côté deux saisons de culture, voire un étalement des récoltes sur toute l’année ; de l’autre une saison chaude et pluvieuse de plus en plus courte aux approches du tropique, des travaux à mener rapidement, une pluviosité incertaine, de longues soudures. D’une part les spectaculaires défrichements forestiers, de l’autre le combat plus discret, mais plus rude, contre l’herbe envahissante. En forêt humide, des combinaisons complexes où racines et tubercules l’emportent, dominées par les arbustes, les bananiers, les palmiers à huile ; en savane, des associations plus simples de céréales et de légumineuses et, sauf pour les “”parcs” d’arbres sélectionnés dans les formations naturelles, l’absence de plantes productives pérennes. En zone sahélienne et moins systématiquement en zone soudanienne, la présence du bétail, associé ou non à l’agriculture ; en forêt, pour cause de trypanosomiase, la quasi-absence des bovins”.
Les agriculteurs africains innovent dans leurs pratiques, en utilisant par exemple des plantes importées. En revanche, l’utilisation de l’eau n’est pas maîtrisée. Les multiples vallons qui, au Buganda, bordent le lac Victoria, restés marécageux, sont inoccupées et malsains. Le drainage des vallées nécessite prélablement l’industrialisation. Dans de petites régions, l’irrigation est cependant pratiquée (régions sénégambiennes et guinéennes).
Le travail se fait avec un outillage très traditionnel qui ignore bien souvent la roue : “l’agriculture sud-saharienne, y compris aux franges orientales, soumises à l’influence indienne, a systématiquement ignoré la charette, pourtant plus indispensable que la charrue (...)”. Le travail du sol est lent : “quarante jours pour houer un hactare”. Agriculture intensive et extensive cohabitent.
L’élevage est pratiqué partout sauf dans les régions atteinte par la trypanosomiase.
Les brûlis (forestiers et des prairies d’herbes) sont pratiqués à “une masse de végétation suffisante pour fournir en abandondance aux plantes des cendres et donc des aliments minéraux”. L’herbe des savanes est extirpée pour cultiver. Les associations de végétaux sont très étudiés ; les champs hétérogènes.