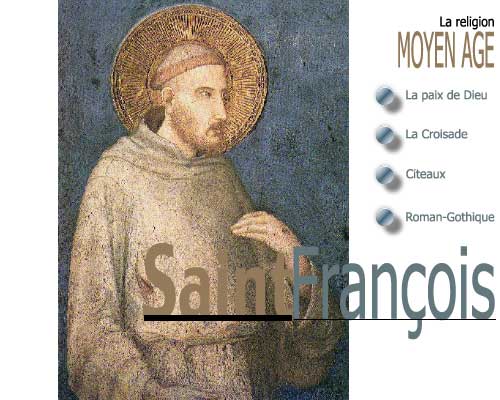|
|
Préambule
Une des difficultés du métier d’historien est de "débroussailler" des sources religieuses - par exemple hagiographiques - sans disposer toujours d’autres matériaux pour les critiquer. Ce problème est de toute évidence posé au biographe de Saint François ; placé entre Bonaventure et Thomas de Célano, ennuyé par la perte définitive de la première règle. A mon modeste niveau, devant le mythe de la lutte de Poséidon et d’Athéna pour l’Attique, je me demandais bien ce qu’il fallait extraire de rationnel. Chaque année, l’étude en classe de sixième des Hébreux suscite des questionnements : comment extraire de la Bible des connaissances utilisables ? Comment distinguer le probable de la certitude et du religieux ? Le passage de Moïse dans la mer Rouge s’explique-t-il par un phénomène météorologique déformé dans la Bible ? Faut-il simplement l’évoquer ou privilégier le sens profond des Dix commandements, les premières lois de l’histoire de l’humanité ? Mais revenons à François.
Ambitions de l'auteur
Le Goff, un maître de la biographie, auteur d’un magistral Saint Louis, où le médiéviste s’interroge justement sur la bonne méthode, dépasse le problème avec beaucoup d’habilité et d'honnêteté : les formulations laissent place au doute et à l’interrogation ; la fiabilité des témoignages est parfois franchement remise en cause ; des zones d’ombre subsistent inévitablement : que s’est-il réellement passé entre le pape Innocent III et François ; la prédication aux oiseaux est-elle une invention ? De même pour l'épisode où François est poussé dans la neige par des bandits.
L’auteur ambitionne plus largement de placer Saint François dans le contexte historique d’un Occident en croissance, marqué par l’inurbamento en Italie et les grands mouvements de défrichements du XIIIe ; d’une Église qui cherche alors un second souffle en rejetant les dérives du nicolaïsme et de la simonie en fondant des ordres nouveaux qui reviennent au source du monachisme bénédictin (Citeaux créé par Robert de Molesme en est l’exemple). Notons que le texte de Le Goff n'est pas une véritable biographie mais une compilation de ses contributions diverses sur le sujet.
Interrogations de François
Or François est un enfant de la ville qui s’interroge doublement sur cette société en croissance : la présence divine est-elle dans toutes les créatures ? Faut -il préférer la mendicité au travail ?
Dans notre époque avide du gain où le travail est sanctifié, un homme qui se met nu pour signifier à son père qu’il renonce à son héritage afin d’imiter le Christ passerait pour un fou ou un sectaire ; à l’inverse, la pensée de Saint François peut rencontrer la conscience attentive du contemporain qui doute sur la valeur du travail et de la richesse.
De son vivant, Saint François eut beaucoup de mal à maintenir l’unité autour de son nom et ce fut -semble-t-il - la raison de son retrait en 1224. Les fraticelles, ces hérétiques, ne sont-ils pas des dissidents du mouvement franciscain.
Jalons biographiques
François est un homme qui connaît parfaitement le français et prêche parfois dans cette langue malgré sa naissance à Assise. Il gerroye avec sa ville contre Pérouse par exemple, participe vraisemblablement à l’édification de ses remparts avant de troquer sa vie à la manière des nobles pour une simple robe et une corde autour de la taille. La maladie est sans doute la première cause de sa renonciation à la vie séculière. Suivent des années de prêches où François reçoit les premiers signes divin, vend les draps de son père pour permettre la réfection de l’église de San Damiano, donne son manteau entier à un pauvre et non la moitié comme jadis Saint Martin, s’installe dans un oratoire perdu dans les bois la Porziuncola qui deviendra sa demeure, rallie de plus en plus de gens avec la connaissance des miracles qu’il accomplit là où il se rend, missionne dans les années 1208 et 1209, arrache au pape sa règle ; parle de Dieu aux adorateurs d’Allah.
Finalement, de nouveau malade, François se retire entre 1224 et 1226 et reçoit les stigmates. Il meurt en 1226. Le pape s'empresse de le canoniser pour taire les controverses. Sur sa tombe les miracles commencent, relatés dans la vie de Saint Antoine de Padoue : "Là les yeux des aveugles se sont ouverts, les oreilles des sourds se sont ouvertes, le boiteux s'est mis à sauter comme un cerf, la langue des muets s'est vite déliée pour clamer les louanges de Dieu (...)".
Cantique du frère Soleil ou des créatures
Très haut, tout puissant et bon Seigneur
à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction
à toi seul ils conviennent ô Toi Très haut
et nul homme n'est digne de te nommer.
Loué sois-tu, Seigneur, avec toutes tes créatures
spécialement messire frère Soleil
par qui tu nous donnes le jour, la lumière
il est beau, rayonnant d'une grande splendeur
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.
Loué sois-tu mon Seigneur pour soeur Lune et les Etoiles
dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu mon Seigneur pour frère Vent,
et pour l'air et pour les nuages
pour l'azur calme et tous les temps
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.
Loué sois-tu mon Seigneur pour sœur Eau
qui est très utile et très sage
précieuse et chaste.
Loué sois-tu mon Seigneur pour frère Feu
par qui tu éclaires la nuit,
il est beau et joyeux,
indomptable et fort.
Loué sois-tu mon Seigneur pour soeur notre mère la Terre
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits
avec les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois-tu mon Seigneur pour ceux
qui pardonnent par amour pour toi,
qui supportent épreuves et maladies,
heureux s'ils conservent la paix
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu mon Seigneur pour notre sœur la Mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper,
malheur à ceux qui meurent en péché mortel,
heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté
car la seconde mort ne pourra leur nuire.
Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le
en toute humilité.
Ce poème nous dit J. Le Goff résume tout l'amour fraternel de François pour toute la création.
Legs
Dans la règle franciscaine est mis en exergue "l'obligation du travail manuel, la nécessité de ne demeurer "qu'en étranger et en pèlerin" dans de pauvres églises et couvents, l'interdiction absolue de demander des privilèges à la cour romaine (...)". Dans un autre domaine, l'arrivée de Saint François aurait contribué à l'ébranlement artistique, prélude à la renaissance italienne.
Dans sa pratique, François est radical, pratique la nudité comme signe du renoncement à la richesse, vante la mendicité, interdit aux frères de percevoir un salaire et appelle la pauvreté une "Grande Dame" (l'argent ne représente pas plus que des cailloux) mais reste dans l'Église du fait de sa croyance dans les sacrements dont l'eucharistie. Ainsi, rappelle l'auteur, il est fréquent de lire que Saint François et Saint Dominique ont sauvé l'Église de l'hérésie.
Le rêve d'une société débarrassée de ses inégalités est très présent jusque dans le récit allégorique d'une marche avec frère Léonard où François descend de son âne pour le proposer à son compagnon qui le suivait à pied ; François consent à ce geste parce que -dans le siècle- Léonard était plus puissant. Pourtant François n'échappe pas à sa fascination pour le monde chevaleresque ; lui et ses frères sont les chevaliers de Dieu.
Si François est conservateur par la place qu'il réserve à la famille (la communauté est une grande famille dont il est le père), par sa méfiance pour les universitaires ("un grand clerc doit renoncer même à la science quand il entre dans l'Ordre, afin que, débarassé de cette possession, il s'offre nu au bras du Crucufix"), il est novateur dans sa façon de placer le Christ et non ses apôtres au centre ; de choisir une vie immergée dans la ville et non décentrée dans la campagne comme les Cisterciens (à son arrivée dans les cités qu'il visite, François est acclamé et provoque un attroupement aux cris de "le saint arrive") ; en proposant un idéal positif fondé sur l'amour des créatures. Certes la vie de François est aussi rythmée par des moments intenses de retraites ; reste que l'emporte le besoin d'abolir la différence entre laïcs et clercs. A ce titre, la prédication est placée au centre de la pratique franciscaine comme le besoin de se tourner vers ceux qui sont en marge ; par exemple les lépreux.
Le Goff, Saint François d'Assise, Gallimard |
|