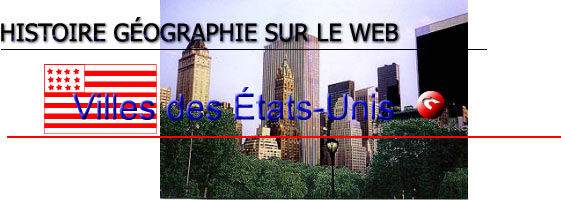
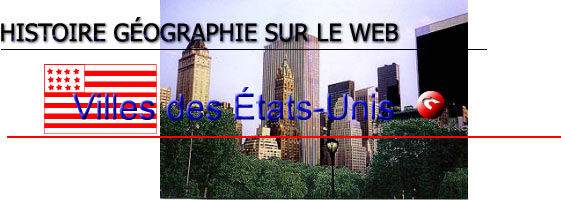 |
|

| Quelle est la population de l'agglomération de New-York ? | 13 millions d'habitants
22 millions d'habitants 18 millions d'habitants |
| Comment appelle-t-on la mégalopolis de la côte est ? | La "grosse pomme"
Boswash La Silicon Valley |
| Comment appelle-t-on le centre des affaires des villes américaines ? | La City
Le Central Business District La Federal Housing Administration |
| Le nombre de métropoles millionnaires aux États-Unis est de : | 32
27 21 |
| La seconde mégalopolis en formation se situe entre : | Chicago et Detroit
Seattle et Los Angeles Los Angeles et San Diego |
| Le centre-ville est plutôt occupé par : | Des populations pauvres
Des populations riches Des classes moyennes |
| La ville qui possède le plus de sièges sociaux de grandes entreprises est : | Miami
New-York Los Angeles |
| La superficie de Los Angeles est de : | 15 000 km2
10 000 km2 20 000 km2 |
| Le District federal de Washington correspond : | à la ville même
à l'agglomération |
| La Silicon Valley se situe dans la région de : | Seattle
Los Angeles San Francisco |
| Chicago fait face au lac : | Michigan
Ontario Erié |
| L'industrie majeure de Detroit est : | la sidérurgie
l'automobile le textile |
| La seule rue qui n'est pas rectiligne dans Manhattan est : | Madison avenue
Broadway La cinquième avenue |
| Chicago est aujourd'hui la capitale : | Du crime
du cinéma des transports |
| Hollywood se situe dans la banlieue : | de Los Angeles
De Dallas De San Francisco |
| Cette ville est au bord du Mississippi, c'est : | Kansas City
Saint-Louis Mobile |

New-York de l'Empire State Building
| Extrait de la Géographie Universelle (Antoine Bailly et Gérard Dorel) Le centre-ville, symbole de la puissance Dans ce jeu, le centre-ville conserve son poids symbolique et, plus difficilement, une partie de son pouvoir économique. John Dos Passos, Michel Serres et bien d'autres ont parfaitement décrit la ville américaine et son centre. De la banlieue au bureau, après le passage obligé dans les îlots miséreux du ghetto, le commuter, ce migrant de tous les jours, se heurte brutalement au centreville. Le contraste est frappant entre la pauvreté des quartiers dégradés de la zone de transition, où vit une population exclue de la société de consommation, et l'opulence des gratte-ciel de la réussite économique. La multiplication, dans une aire privilégiée, le CBD, d'immeubles aux styles architecturaux hétéroclites, traduit la puissance économique des grandes entreprises. À chaque époque son style. Depuis les bâtiments de huit à dix étages armature métallique, de la fin du XIXe siècle à Chicago, la puissance de la sidérurgie se traduit par la multiplication de tours à métallique, de plus en plus élevées. Le verre se substitue à la pierre, faisant passer les immeubles du style néogothique ou grec ancien au postmodeme contemporain. Récemment, de nouvelles possibilités architecturales donnent des formes plus élancées, des éclatements de façades colorées. Banques, assurances, chaînes hôtelières rivalisent par leur architecture, leur volume et leur luxe. Les enseignes lumineuses rappellent ces noms qui marquent les grands centres-villes: Prudential, Hilton, Sheraton... Pour permettre aux employés et aux congressistes de consommer, les rez-de-chaussée des immeubles s'ouvrent aux commerces: fast-food aux enseignes standardisées des chaînes de toutes sortes, cinémas, théâtres, boutiques de vêtements constituent ce paysage fabriqué que l'on retrouve d'un bout à l'autre de l'Amérique. Le centre-ville porte les signes d'une société conditionnée pour consommer. Ces agoras des temps modemes que sont les halls d'entrée des gratte-ciel offrent des espaces publics où le col blanc pourra déjeuner et faire des emplettes avant de retoumer dans sa banlieue ou dans un immeuble cossu du voisinage. Le contraste est pourtant brutal entre le luxe de ces édifices privés et les espaces publics, souvent mal entretenus. Sortir d'un gratte-ciel ou du salon luxueux de l'hôtel, c'est être exposé à la ville et à ses risques. Sur les trottoirs défoncés errent, surtout la nuit, les exclus de la société urbaine; l'extérieur devient synonyme d'insécurité, par opposition à l'intérieur confortable des immeubles. La population urbaine centrale change d'ailleurs rapidement entre le jour et la nuit: à Il heures sortent les cols blancs, progressivement remplacés par une population nocturne, beaucoup plus colorée, issue des ghettos voisins. Le ludique se substitue au fonctionnel et la ville se met à respirer le danger. dans ces centres que d'enjeux ! Enjeux pour la possession d'un sol devenu rare, mais prestigieux; enjeux pour bénéficier des meilleures cotisations; enjeux pour conserver son emprise et ses activités. La rente foncière s'envole, car seul le centre peut fournir tous les avantages de la proximité: bourses, banques, activités financières ici, siéges sociaux des assurances là, ailleurs hôtels, centres culturels et théâtres... Le centre est fait d'une mosaïque d'activités, chacune ayant sa place de choix. Et, lorsque la nécessité se fait sentir, le centre déborde sur le ghetto voisin, qui à son tour envahit la proche banlieue, selon ce mouvement d'invasions successives si bien analysé par l'école de Chicago. Et l'agglomération continue à s'étendre en tache d'huile, repoussant ghettos et banlieues. |
| Extrait de "Naissance de l'Amérique urbaine 1820-1920" par François Weil Naissance du Gratte-Ciel La ville modeme était enfin caractérisée par le développement spectaculaire de sa dimension verticale. Cette mutation, provoquée par le prix des terrains dans les centres des villes, fut rendue possible par des innovations techniques, et notamment le passage de la construction en brique et en maçonnerie à la construction par ossature métallique qui permit de dépasser les limites de la ville victorienne (qui atteignait au maximum de 5 à 10 étages). La conséquence fut une transformation du paysage urbain et un passage d'une ville basse » à une ville verticale, avant tout à New York et à Chicago. Cette transformation fut rythmée par la construction de grands immeubles, appelés gratte-ciel » (skyscrapers), dont le gremier fut en 1885 le Home Insurance Building construit à Chicago par Le Baron Jenney. Davantage-que par ses. dix étages le bâtiment était surtout remarquable par son ossature d'acier. Chicago fut la ville pionnière en matière de gratte-ciel et abrita les plus grands architectes du temps, Daniel Burnham, Louis Sullivan et Dankmar Adler - l' école » architecturale de Chicago. Sullivan, né à Boston en 1856, fils d'un maître de danse irlandais et d'une mère franco-suisse, avait fait ses études à Boston et étudié l'architecture au Massachusetts Institute of Technology, sous la houlette de William Ware, un disciple de Richard Morris Hunt qui avait importé aux Etats-Unis dans les années 1840 les théories et les pratiques de l'architecture française. Sullivan lui même étudia à Paris aux Beaux-Arts en 1874-1875, avant de s'installer à Chicago et de s'associer avec Dankrnar Adler jusqu'en 1895. On lui doit par exemple l'Auditorium de Chicago (1889). Pour autant, c'est à New York que la notion de verticale prit le plus de force, avec en particulier la construction du Woolworth Building en 1913. Construit par l'architecte Cass Gilbert pour le propriétaire de la chaîne des magasins bon marché Woolworth, ce gratte-ciel de 55 étages atteignait une hauteur de 241 mètres, qui en faisait le plus haut bâtiment du monde jusqu'à la construction du Chrysler Building à New York en 1929. D'inspiration néo-gothique, il devint le principal symbole de la modernité du paysage urbain new-yorkais - d'où son surnom de cathédrale du commerce ». Et le Woolworth Building n'était pas le seul. New-York comptait notamment le gratte-ciel de la Metropolitan Life Insurance Company, construit en 1907-1908 dans le style renaissance italienne, et dont les 45 étages atteignaient 200 mètres de haut. En 1910, New York avait deux fois plus de gratte-ciel que Chicago, et la prolifération de ces écorcheurs de nuages » rendit bientôt nécessaire la loi sur l'aménagement urbain de 1916, qui réglementa la hauteur des nouvelles constructions - qui ne devrait pas dépasser deux fois et demie la largeur de la rue, et dont la surface par étage devrait diminuer avec l'élévation. |
| Le centre des grandes villes américaines est réservé aux affaires avec le siège social de grandes entreprises. Chicago, seconde ville des USA avec 10 millions d'habitants dans l'agglomération, a son CBD (Central Business District) appelé "loop" contre le lac Michigan, reconnaissable aux imposants gratte-ciel. Les grandes villes américaines sont des centres de décisions et des villes financières avec des banques et des sièges sociaux (New-York au premier rang et Miami au second pour les banques).
Ce centre est généralement entouré de quartiers défavorisés. Les villes sont organisées en quartiers avec des rues à angles droits. Certains quartiers sont à dominante ethnique (Chinatown, Little Sicilia à New-York ou Harlem pour les noirs).
Au-delà les banlieues (suburbs) s'étalent sur de très grandes distances. Les populations riches y résident dans des maisons individuelles avec jardin et parfois piscine. Les riches ou les classes moyennes résident dans les banlieues plus lointaines. Les villes connaissent donc plusieurs types de problèmes : la circulation car les villes sont submergées par les voitures ; la pauvreté des villes par rapport au banlieue pose le problème de la gestion des villes (déficit budgétaire chronique) ; la criminalité et la pauvreté (SDF et quartiers insalubres) sont les deux derniers problèmes des villes américaines. La megalopolis est une agglomération qui s'étend de Boston à Washington (Boswash) sur 100 km. Ces grands villes sont des ports, de grands centres économiques. Les communications sont facilitées par les moyens de transports. À l'ouest l'urbanisation de San Diego à Los Angeles forme une seconde megalopole de 20 millions d'habitants. |
Pour anticiper : un site prévu pour les élèves de terminale, très bien réalisé